/image%2F0991784%2F20210501%2Fob_3d3c77_stowaway.jpg)
Le Passager n°4 (Stowaway - 2021) :
En mission pour Mars, l'équipage du MTS-42 (Toni Collette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim) découvre soudain à son bord un passager clandestin, Michael (Shamier Anderson), qui ignore totalement comment il est arrivé là. Confrontés à une réserve d'oxygène insuffisante pour les quatre passagers, les trois astronautes se trouvent alors face à un choix drastique : sacrifier cet inconnu, ou risquer la vie de tout l'équipage.
Stowaway est un long-métrage Netflix qui pose un dilemme moral percutant et pertinent à ses personnages cartésiens et scientifiques : quel choix effectuer lorsque les ressources deviennent soudain limitées et qu'il faut "sacrifier" un passager pour espérer assurer la survie du reste de l'équipage.
On aurait pu réaliser le même film dans un sous-marin, sur un bateau à la dérive, lors d'une expédition polaire... les choix sont multiples, et reposent tous sur la même question fondamentale, traitée à de multiples reprises dans la fiction (Stowaway n'est guère plus qu'une relecture "réaliste" de l'Équation de la mort, un épisode de la Quatrième Dimension adapté d'une nouvelle, elle-même inspirée d'autres récits), et opposant la logique pragmatique de la survie du plus grand nombre à la réaction émotionnelle de la valeur de toute vie.
Et le film fait tout pour embarquer le spectateur dans ce débat : mise en place prenante, réalisation et rendu visuel efficaces, acteurs compétents, et caractérisation très appuyée du passager clandestin, qui est présenté comme quelqu'un de courageux, d'intelligent, de travailleur, de sociable et de sympathique, pour mieux remuer le couteau dans la plaie lorsque vient le moment de la décision fatidique.
Le seul vrai problème, en fait, c'est que pour adhérer à la proposition du film, et pour que la suspension d'incrédulité fonctionne, il faut trouver le postulat du métrage plausible ; et c'est là que tout s'écroule, pour moi. Parce que le film choisit délibérément de botter en touche sur le pourquoi et le comment de la présence à bord de ce passager clandestin, et qu'à mes yeux, c'est là le début de l'effet domino qui fait s'effondrer tout le château de cartes Stowaway.
Car se contenter d'un "Michael est un préparateur technique qui travaillait sur la navette lorsqu'elle était sur sa rampe de lancement... et voilà, c'est tout, il s'est réveillé à bord après le décollage et l’arrimage à la station, et ne sait pas comment il est arrivé là", c'est loin d'être suffisant, surtout que cela ne semble poser de problème à personne, avec un équipage qui accepte volontiers à son bord cet inconnu sympathique.
Ça aurait pu passer si le film s'était engagé dans la direction d'un thriller, avec un 4e passager menteur et menaçant... mais non, Stowaway n'est intéressé que par son dilemme éthique, et considère que cette absence d'explications n'est pas un obstacle au bon déroulement du récit.
Sauf que bon, pas de postulat justifié, des rebondissements artificiels et forcés (l'éruption solaire qui tombe forcément pile au pire moment, sans prévenir), des personnages assez peu développés (Toni Collette est sous-exploitée), un rythme globalement pépère et sans grande tension et une résolution ultra-prévisible avec morale en voix off, à force, ça commence à faire beaucoup.
D'autant plus frustrant que ça commençait bien, avec vingt premières minutes très efficaces.
2.5/6
--
Et comme toujours, vous pouvez retrouver la liste complète de tous les films passés en revue sur ce blog dans le menu Index de haut de page, ou en cliquant directement sur ce lien (000-1000) et sur celui-ci (1001-2000)...

/image%2F0991784%2F20140708%2Fob_71ee5e_mmm.jpg)

/image%2F0991784%2F20220622%2Fob_0f1d7d_ms-marvel-0.jpg)
/image%2F0991784%2F20220715%2Fob_c962c4_mm2.jpg)
/image%2F0991784%2F20220715%2Fob_e3a85a_mm1.jpg)
/image%2F0991784%2F20211223%2Fob_3c9a95_hwk.jpg)
/image%2F0991784%2F20211223%2Fob_4888c9_yelena-1200x675.jpg)
/image%2F0991784%2F20211223%2Fob_9ea7f0_hawkeye-alaqua-cox-1014x570.jpg)
/image%2F0991784%2F20211223%2Fob_cf23e3_hawkeye-kate-bishop-clint-barton.jpg)
/image%2F0991784%2F20230105%2Fob_1fd36c_lv.jpg)
/image%2F0991784%2F20221109%2Fob_d90150_s-l500.jpg)
/image%2F0991784%2F20230126%2Fob_c1d978_rawimage.png)
/image%2F0991784%2F20230126%2Fob_c4d068_9fed47799a4e4ebc0ac3432fc874bd8c84-lut.jpg)
/image%2F0991784%2F20230302%2Fob_26c7a2_2210923.jpg)
/image%2F0991784%2F20230312%2Fob_468b7f_glass.jpg)
/image%2F0991784%2F20210918%2Fob_939722_candy.jpg)
/image%2F0991784%2F20210311%2Fob_017eaa_mv5bmtc5njqymzqynv5bml5banbnxkftztcwmz.jpg)
/image%2F0991784%2F20210729%2Fob_a0ace5_mv5bzgjjyzu0ytmtntvmny00zjlklwezowytnd.jpg)
/image%2F0991784%2F20210404%2Fob_825b8f_jp.jpg)
/image%2F0991784%2F20210407%2Fob_6d80b1_kids.jpg)
/image%2F0991784%2F20210407%2Fob_cdc8f7_bump.jpg)
/image%2F0991784%2F20230103%2Fob_5d7e00_prod.jpg)
/image%2F0991784%2F20230417%2Fob_9901a2_stp2.jpg)
/image%2F0991784%2F20230417%2Fob_5ad872_stp.jpg)
/image%2F0991784%2F20230417%2Fob_61c4e8_stp3.jpg)
/image%2F0991784%2F20211213%2Fob_444628_nisser.jpg)
/image%2F0991784%2F20211227%2Fob_df34ba_elves.jpg)
/image%2F0991784%2F20211227%2Fob_dab4c9_keeko.jpg)
/image%2F0991784%2F20221003%2Fob_28bf03_mv5bodcxyzi1mtktzwyznc00mgzllwi3zjytnz.jpg)
/image%2F0991784%2F20220306%2Fob_148444_satur.jpg)
/image%2F0991784%2F20220309%2Fob_9b4f87_saturday-morning-netflix.jpg)
/image%2F0991784%2F20220309%2Fob_f01908_saturdaymorningallstarhits-season1-ep.jpg)
/image%2F0991784%2F20220309%2Fob_3b0774_season-1-trailer-saturday-morning-all.jpg)

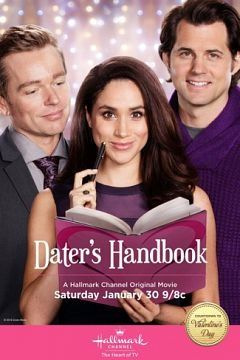

/image%2F0991784%2F20220923%2Fob_ecac10_lds-s3-poster.jpg)
/image%2F0991784%2F20221020%2Fob_f80458_lds-301-post-01.jpg)
/image%2F0991784%2F20221021%2Fob_1c0ad3_loww.jpg)
/image%2F0991784%2F20221021%2Fob_d29992_ld.jpg)
/image%2F0991784%2F20221230%2Fob_49ec2c_myth.jpg)
/image%2F0991784%2F20230115%2Fob_d349c0_fl.png)
/image%2F0991784%2F20230115%2Fob_55b25a_joe.jpg)
/image%2F0991784%2F20230115%2Fob_d29ca3_yxm.jpg)
/image%2F0991784%2F20220119%2Fob_d53e68_static-assets-upload745797946172495843.jpg)
/image%2F0991784%2F20220127%2Fob_7d1861_jww.jpg)
/image%2F0991784%2F20220127%2Fob_3fe1cb_jww2.jpg)
/image%2F0991784%2F20220213%2Fob_d9a778_uncharted-poster-full-1642086040683.jpg)
/image%2F0991784%2F20220213%2Fob_8aca26_images.jpg)
/image%2F0991784%2F20220217%2Fob_973341_hit-monkey-hulu-bryce.jpg)
/image%2F0991784%2F20220217%2Fob_742a69_hit-monkey-hulu-monkey.jpg)
/image%2F0991784%2F20210821%2Fob_649750_fear2.jpg)
/image%2F0991784%2F20230513%2Fob_8aaf0c_edr.jpg)
/image%2F0991784%2F20220727%2Fob_8f123b_22solar-opposites22-season-3-key-art-v.jpg)
/image%2F0991784%2F20220730%2Fob_b7fa71_tr.jpg)
/image%2F0991784%2F20220730%2Fob_dc6cec_pb.jpg)
/image%2F0991784%2F20230710%2Fob_b56e81_nimonastills11.jpg)
/image%2F0991784%2F20230610%2Fob_af804f_trek.jpg)
/image%2F0991784%2F20230814%2Fob_090a99_stnw.jpg)