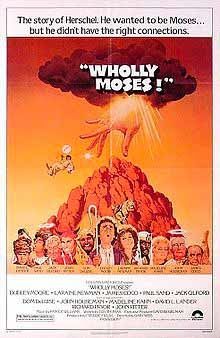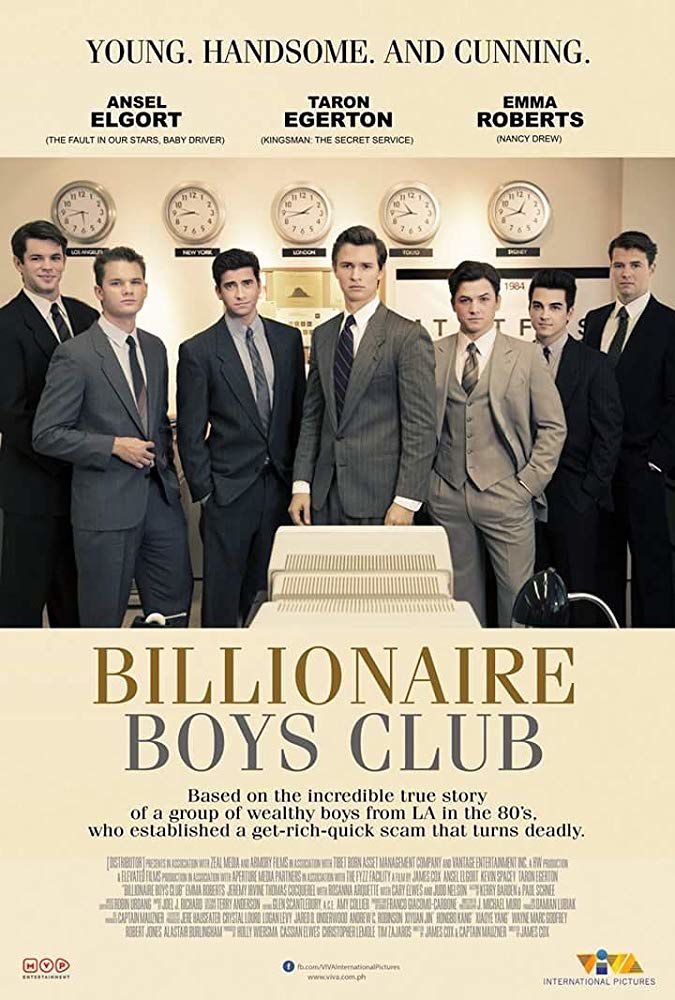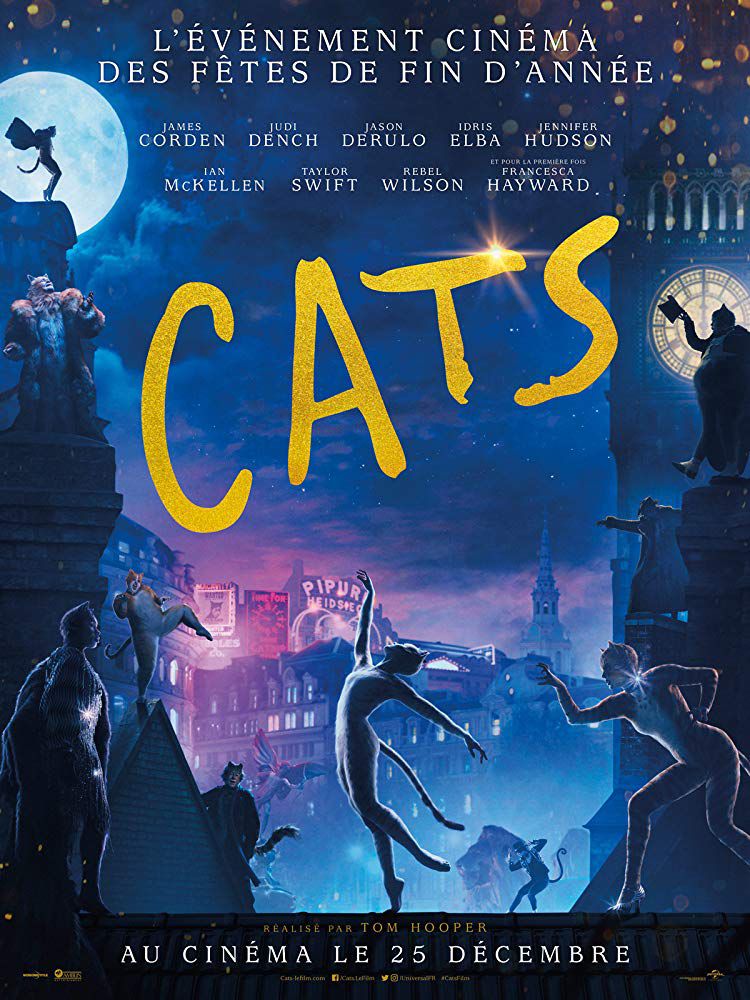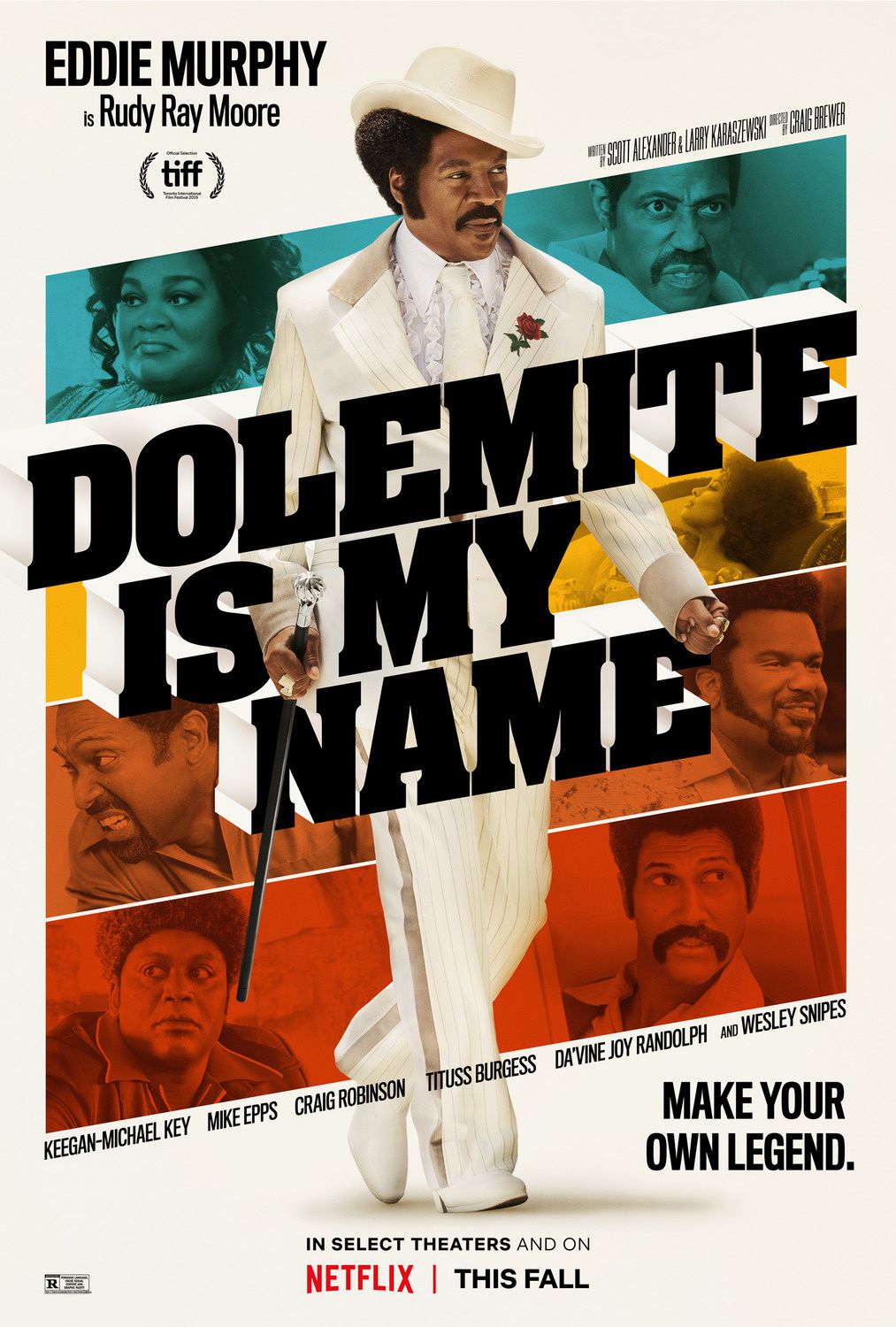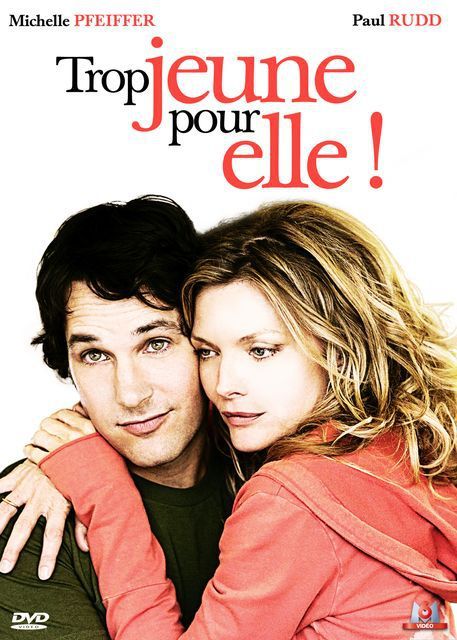Marvel Stories - Marvel Renaissance (2014) :
Documentaire français co-signé par Phillipe Guedj (un habitué de certains sites de genre français) et d'une durée d'une petite heure revenant en détail sur le gros passage à vide financier de la firme Marvel, dans les années 90, et sur la manière dont la compagnie a su remonter la pente pour devenir le colosse que l'on connaît aujourd'hui.
Ici, on ne s'attarde pas vraiment sur le côté créatif des choses, mais vraiment sur l'aspect business et économique de la Maison aux Idées : comment le lent déclin des ventes de comics dans les années 80-90, et la lente transformation des comics en objets spéculatifs plus qu'en œuvres créatives, a mené au rachat de la société par Ron Perelman, un businessman sans le moindre intérêt pour le monde des superhéros, qui a aussitôt mis Marvel en bourse ; comment la bulle spéculative a mené à la faillite de Marvel en 1996, et à l'arrivée de Carl Icahn, un financier aux dents longues ; comment Avi Arad et Ike Perlmutter, associés au sein de Toy Biz, un fabricant de jouets, sont arrivés à bord, le premier pour s'occuper du côté créatif, le second pour gérer les affaires de la boîte ; comment, sous l'impulsion d'Arad, Marvel s'est diversifiée en se tournant vers le cinéma, en développant ses produits dérivés, puis en recrutant de nouveaux talents et en lançant la collection Ultimate permettant de rebooter l'univers Marvel et de le rendre accessible à un nouveau public issu du cinéma.
Et bien sûr, comment les Marvel Studios ont été créés, et comment, progressivement, le succès de ces derniers s'est bâti, grâce au rachat par Disney, et parfois au détriment de certains des protagonistes de cette histoire de gros sous (Avi Arad, notamment, qui a choisi de partir lorsqu'il a vu qu'il tombait en défaveur auprès de Perlmutter).
Tout cela, à grand renforts d'interviews de créateurs et de personnes ayant vécu ces événements, d'Avi Arad à Jimmy Palmiotti en passant par Mark Waid, Louis Leterrier, Mark Millar, Tom DeSanto, et bien d'autres encore, pour un récit assez intéressant, parfois amusant (Ike Perlmutter décrit par tout le monde comme un "Dr Doom" pingre, autoritaire et totalement obsédé par l'argent), et dont on aurait aimé qu'il soit un peu plus long.
4.5/6

Marvel Stories - Marvel Univers (2016) :
Suite indirecte du précédent métrage, qui développe ici, sur une durée de moins de 80 minutes, trois axes principaux : tout d'abord, un segment consacré à la collectionnite aiguë qui entoure le monde des comics, la bulle spéculatrice qui fait des anciens numéros des objets dans lesquels investir, et qu'il faut stocker dans des conditions impeccables pour qu'ils ne perdent pas de valeur.
Honnêtement pas très intéressant, tout ça : voir des entrepreneurs faire la promotion de leur business, et négocier encore et encore pour conclure des accords de plusieurs centaines de milliers de dollars, ça n'a pas grand chose de fascinant ou de passionnant pour moi.
Le second segment, consacré aux liens intrinsèques et indéfectibles entre Marvel et la ville de New York, partie intégrante de l'identité de l'entreprise, de ses personnages, et du lien tangible existant entre les lecteurs de comics et l'univers Marvel, est déjà beaucoup plus convaincant, avec notamment des interventions de Xavier Fournier (ex Comic Box), entre autres.
Le documentaire effectue enfin un virage vers la Californie, pour s'intéresser à l'histoire cinématographique de Marvel Studios (on rejoint ici un peu la fin de Marvel Renaissance, dont on retrouve certains intervenants et certains morceaux d'interventions) et développer la stratégie et le savoir-faire de Kevin Feige et de Marvel, avec des prédictions assez amusantes à voir aujourd'hui, maintenant que l'on a plusieurs années de recul.
Plutôt agréable à suivre, même si j'ai beaucoup de réserves sur les interventions du journaliste de Deadline, assez cynique et agaçant.
Dans l'ensemble, un documentaire inégal, qui ne m'a pas vraiment intéressé dans sa première partie, mais s'avère pertinent dans les deux suivantes. Après, n'aurait-il pas mieux valu structurer tout ça autrement, en intégrant par exemple la partie MCU à Marvel Renaissance ?
3.5/6
--
Et comme toujours, vous pouvez retrouver la liste complète de tous les films passés en revue sur ce blog dans le menu Index de haut de page, ou en cliquant directement sur ce lien (000-1000) et sur celui-ci (1001-2000)...

/image%2F0991784%2F20140708%2Fob_71ee5e_mmm.jpg)